Littérature
Littérature

La littérature japonaise s'étend sur une période de quinze siècles d'écrits. Les premières œuvres sont très fortement influencées par la littérature chinoise, mais la politique d'isolement du Japon a permis le développement de formes littéraires uniques. Quand le Japon a dû assez subitement s'ouvrir au xixe siècle, le choc a eu une certaine influence sur la littérature japonaise qui a développé des caractéristiques modernes singulières. Les caractéristiques générales de la littérature japonaise sont un certain sens du détachement, l'isolement, l'éloignement, et, dans beaucoup de cas, le héros ou personnage central échoue dans ses efforts.
Bref historique
Les premières écritures recensées sont des inscriptions sur des épées de la période Kofun (250-538).
De la période Asuka (538-710) datent la Constitution en 17 articles (604) du prince Shōtoku (574-622), publiée en 720, la Réforme de Taika (645, ère Taika), et des commentaires des sutras bouddhistes.
Les deux plus anciens textes historiques japonais, écrits pendant l’époque Nara (710-794) présentent l’histoire japonaise à la façon des historiens chinois. La poésie est de type kanshi et waka.
À l’époque Heian, les livres sont écrits principalement en caractères kana et non pas en caractères chinois. Les ouvrages les plus célèbres de cette époque sont « Le Dit du Genji » (Genji Monogatari) de Murasaki Shikibu, une dame de la cour, et « Notes de Chevet » de Sei Shōnagon, dame de compagnie de l’impératrice.
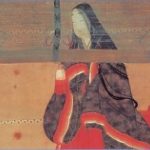
Les thèmes de ces écrits sont la vie, l’amour et les passe-temps des nobles à la Cour de l’empereur.
La littérature japonaise médiévale (XIIe – XVIIe) est marquée par une forte influence du bouddhisme zen : les personnages y sont des prêtres, des voyageurs ou des poètes ascétiques. Durant cette période, le Japon souffre de nombreuses guerres civiles qui entraînent le développement d’une classe de guerriers et de samouraïs, entourés de contes, histoires et légendes. Le système des écritures du japonais se met en place, mêlant kana et kanji. Le genre de poésie collaborative renga s’établit, avec entre autres Nijō Yoshimoto. Le théâtre Nô se développe, et atteint son apogée, avec Zeami.
L’Époque d’Edo, voit le développement du roman, de la poésie et du théâtre. La pensée et la littérature chinoises continuent à être la grande référence. Mais l’éducation se recentre sur les classiques japonais, qu’il s’agit de redécouvrir, surtout depuis que la lecture du kanji a pratiquement disparu.
Le mode de vie urbain (Chōnindō) permet un développement des arts, de la littérature et du divertissement, dont le monde flottant de l’ukiyo. Parmi les plus grands noms en littérature on retiendra Ihara Saikaku et Ueda Akinari.
À partir de la restauration de Meiji (1968), la littérature japonaise moderne est marquée par l’ouverture du Japon et son exposition au monde occidental. Le roman à la première personne prédomine. La littérature combine les influences existentialistes des anciens écrits zen et les réalités du monde actuel en les plaçant dans un contexte moderne où le progrès rapide ne sert qu’à exacerber le sentiment d’aliénation ressenti par l’auteur. L’impérialisme japonais en Corée et en Mandchourie, puis la défaite de 1945, sont présents chez de nombreux écrivains.
Des écrivains que j’aime

Sei Shōnagon(~965 - ?)
On ne connaît pas grand chose de la vie de Sei Shōnagon, née vers 965 dans le clan Kiyohara. Fille de Kiyohara no Motosuke, elle appartient à la cour de l’empereur Ichijō et elle devient en 991 dame de compagnie de l’impératrice Fujiwara no Teishi /Sadako. Après la mort en couches de celle-ci en 1001, elle quitte la cour impériale. On ne sait rien de certain de sa vie ultérieure.
- Notes de chevet (Makura no soshi, 1001~1010)

Ihara Saikaku(1642 - 1693)
Ihara Saikaku, né Hirayama Tōgo, est considéré comme le grand maître du genre dit ukiyo-zōshi , littéralement « texte du monde flottant »), sorte d’équivalent en prose de la peinture ukiyo-e.
Il s’essaie d’abord à la poésie Haikai (très courts poèmes), puis se toune, à 40 ans, vers la prose. Il produit alors une vingtaine d’œuvres que l’on peut classer en quatre catégories : amour charnel, histoires de guerriers, histoires de marchands et recueils de contes.
- Contes d’amour des samouraïs
- Cinq amoureuses
- Vie d’une amie de la volupté (le cinéaste Mizoguchi en a tiré en 1952 le film La Vie d’O’Haru femme galante)
- Du devoir des guerriers
- Arashi, vie et mort d’un acteur

Ueda Akinari(1734 - 1809)
Fils d’une courtisane de Sonezaki, le quartier des plaisirs d’Ōsaka, et de père inconnu, Ueda Akinari est abandonné par sa mère à l’âge de 4 ans. Il est recueilli par un riche marchand de papier et d’huile nommé Ueda. Ce dernier, n’ayant qu’une fille, en fait son héritier et lui donne l’éducation soignée d’un fils de riches commerçants.
En 1761, à la mort de son père adoptif, il reprend son commerce, mais ne se révèle pas être un excellent homme d’affaires. Il perd son échoppe dans un incendie 10 ans après. En parallèle, il publie plusieurs histoires humoristiques du genre littéraire ukiyo-zōshi.
Considérant cet incendie comme une occasion pour lui de quitter le monde des affaires, Akinari commence des études de médecine.En 1776, il devient médecin et publie, dans le même temps, ses Contes de pluie et de lune, un recueil de neuf contes fantastiques.
En 1793, il s’installe à Kyōto, la capitale. C’est là qu’il entame les Contes de pluie de printemps, œuvre qui sera publiée inachevée. Ueda Akinari meurt à Kyōto le 6 août 1809.
- Les Contes de pluie et de lune (Ugetsu monogatari), recueil de 9 contes fantastiques (le cinéaste Mizoguchi en a adapté 2 pour réaliser son film Les contes de la lune vague après la pluie, en 1953)
- Les Contes de pluie de printemps (Harusame monogatari)

Natsume Sōseki(1867 - 1916)
Né Natsume Kinnosuke, c’est un auteur de romans et de nouvelles, très représentatif de la transition du Japon vers la modernité, pendant l’ère Meiji. Enfant non désiré, il est confié à l’âge de deux ans à un couple de serviteurs, Shiobara Masanosuke et sa femme. Il restera avec eux jusqu’à leur divorce, alors qu’il est âgé de neuf ans. À son retour dans sa famille, il est bien accueilli par sa mère mais rejeté par son père. Sa mère meurt en 1881, alors qu’il est âgé de 14 ans.
Au collège, il se passionne pour la littérature chinoise et se destine à l’écriture. Mais quand il entre à l’université de Tōkyō en septembre 1884, il est obligé de commencer des études d’architecture et étudie en même temps l’anglais.
En 1887, il rencontre Masaoka Shiki qui le pousse à écrire et l’initie à la composition des haïkus. En 1888, il prend comme nom de plume Sōseki. En 1890, il entre au département d’anglais de l’université de Tōkyō et obtient son diplôme en 1893. Au cours de ses études, il écrit plusieurs articles, notamment sur les poètes anglais et sur le roman Tristram Shandy, de Laurence Sterne. Il commence à enseigner en 1893.
En 1895, il est nommé professeur à Matsuyama et son expérience donnera lieu dix ans plus tard à l’écriture de Botchan. Puis, en 1896, il part habiter et enseigner à Kumamoto (Kyūshū), où il restera quatre ans.
Le gouvernement japonais l’envoie étudier en Angleterre, d’octobre 1900 à janvier 1903. À son retour, il se voit confier la tâche de succéder au prestigieux Lafcadio Hearn comme lecteur de littérature anglaise à l’université de Tōkyō, poste qu’il abandonnera pour se consacrer entièrement à l’écriture à partir de 1907. Son premier livre, Je suis un chat, paraît en 1905. Cette œuvre devient vite un grand succès, de même que Botchan l’année suivante.
Dès lors, bien que de santé fragile, il publie de nombreux romans et nouvelles, à caractère souvent autobiographique. Il meurt à Tōkyō d’un ulcère à l’estomac le 9 décembre 1916, laissant un dernier roman Meian (Clair-Obscur) d’une ampleur exceptionnelle, inachevé.
- Je suis un chat (Wagahai wa neko de aru,1905)
- Botchan (1906)
- Sanchirō (1908)
- Et puis (Sorekara, 1909)
- La porte (Mon, 1910)
- À l’équinoxe et au-delà (Higansugi made, 1912)
- Le Voyageur (Kōjin, 1912)
- Le Pauvre cœur des hommes (Kokoro, 1914)

Higuchi Ichiyō(1872 - 1896)
Malgré une brève carrière (elle meurt de la tuberculose à 24 ans) et un nombre limité d’écrits, Higuchi Ichiyō, née Higuchi Natsu, est reconnue pour la qualité de ses ouvrages et considérée comme la première femme écrivain professionnelle de la littérature moderne japonaise et peut-être la plus grande. C’est sous le signe de la lune, symbole de la mélancolie dans la tradition japonaise, que Higuchi Ichiyō inscrit son œuvre romanesque. L’astre nocturne y est présent, en arrière-plan ou comme personnage à part entière,.
Les récits de Higuchi Ichiyō sont consacrés, en outre, aux malheurs de la femme japonaise. Elles sont décrites comme les premières victimes des mœurs, de la piété filiale notamment, de la pauvreté, d’un mauvais mari, ou encore de la prostitution (elle a habité pendant 10 mois un quartier pauvre à quelques pas de Yoshiwara, le quartier des plaisirs de Tōkyō).
Passionnée par la poésie classique japonaise (waka) où elle excelle, elle laisse une œuvre composée de plusieurs milliers de poèmes, quelques essais littéraires, une vingtaine de nouvelles et un journal intime en plusieurs volumes.
- Le Trente et un décembre (Ôtsugomori, 1894), nouvelle
- Qui est le plus grand ? (Takekurabe, 1895), roman
- La Treizième nuit et autres récits (1892-1895)

Nagai Kafū(1879 - 1859)
Nagai Kafū, pseudonyme de Nagai Sōkichi, est reconnu pour ses œuvres décrivant le Tōkyō du XXe siècle, et particulièrement le monde de la prostitution, des courtisanes et des geishas.
Lors de la naissance de son frère en 1883, il est envoyé dans la famille de sa mère puis rentre chez lui en 1886 lors de son entrée à l’école secondaire.
Diplômé d’une école privée de langue anglaise à Tōkyō en 1897, il devient employé dans le département de langue chinoise d’une université de langues étrangères.
En 1898, Kafū commence à écrire de courtes nouvelles.Deux ans plus tard, il en publie quelques-unes après avoir quitté son poste à l’université. Il trouve par la suite un poste de journaliste et commence l’étude du français.
De 1903 à 1908, il séjourne aux États-Unis, où il est étudiant à l’Université du Michigan. En 1908, il séjourne en France : huit mois à Lyon, et deux mois à Paris. Cela lui permet de publier Amerika monogatari (contes américains) et Furansu monogatari (contes français).
Opposé à l’occidentalisation de la vie japonaise, il tente une redécouverte de la culture de l’époque Edo. Découlent de cette volonté plusieurs textes, dont le roman Le Bambou nain (Okame zasa, 1920), qui évoque la vie des quartiers de geisha et de prostituées, ce « monde des saules et des fleurs ».
- Interminablement la pluie précédée de En eau peu profonde et Feu d’artifice (1912-1922), nouvelles
- Du côté des saules et des fleurs (1918), roman
- Le Bambou nain (1920), roman
- Chronique d’une saison des pluies (1931), roman

Tanizaki Jun'ichirō(1886 - 1965)
L’œuvre de Tanizaki Jun’ichirō révèle une sensibilité frémissante aux passions propres à la nature humaine et une curiosité illimitée des styles et des expressions littéraires.
Il est né en 1886 dans une riche famille marchande d’un vieux quartier de Tōkyō. Choyé au sein de cette grande famille, Jun’ichirō passe plusieurs années de bonheur auprès de sa mère, réputée pour sa beauté, et de sa vieille nourrice affectueuse. Son père n’avait pas une personnalité très forte, Jun’ichirō évoquera l’image d’un homme faible de caractère, incapable de s’adapter à une société japonaise en pleine mutation. Sa première enfance se déroulera dans une ambiance harmonieuse sur le plan affectif et matériel.
Après le décè de son grand-père maternel en 1988, s’amorce un inéluctable déclin familial qu’il ressentira avec acuité. Le sentiment de son humiliation tourmente sérieusement l’adolescent qui ne manque pas d’ambition. C’est durant cette période que naît son amour pour la littérature. L’heureuse rencontre avec Inaba Seikichi, enseignant féru de belles lettres chinoises et japonaises ainsi que de pensée bouddhique, lui permet d’acquérir une maturité littéraire et intellectuelle précoce.
Après avoir projeté de travailler comme journaliste, sa passion pour la création littéraire prédomine. Courts récits romanesques, dialogues de pièces de théâtre, essais, poèmes traditionnels à forme fixe en japonais classique ou en chinois classique, poèmes en japonais moderne ou en nouveau style poétique : ce qui frappe, c’est sa gourmandise linguistique et sa curiosité des différents genres et styles.
Après des débuts difficiles, il est publié pour la première fois en 1910. Nagai Kafū lui consacre un article élogieux en novembre 1911. L’originalité de Tanizaki ? Il accorde une importance primordiale au respect de la nature humaine et à la vraisemblance de sa représentation. Sa sensibilité singulière et son goût de la provocation lui font découvrir en l’homme des aspects troublants, qu’il observe et analyse avec étonnement ou émerveillement, sans les juger, sans préjugés, notamment la faiblesse de caractère, l’absence de volonté, la cruauté, le manque de sincérité, les perversions sexuelles. Tout se joue dans le registre de la beauté et de l’érotisme, au-delà de toute préoccupation morale, religieuse ou spirituelle.
En 1923, le séisme de Kantō l’oblige à chercher un lieu de résidence provisoire dans les provinces de l’ouest du Japon. Il déménage à maintes reprises et se familiarise avec les coutumes de la région de Kyōto-Ōsaka-Kōbe qui porteront des fruits romanesques appréciables. Dans ses récits, le romancier ne cesse de disséminer des réflexions opposant le Japon traditionnel et l’Occident, les deux morales, les deux esthétiques.
À partir de 1928, Tanizaki publie à une cadence surprenante des œuvres innovatrices de grande qualité et qui témoignent en même temps de son imprégnation de la vieille culture japonaise.
En 1936, Tanizaki publie Neko to Shōzō to futari no onna (Le Chat, son maître et ses deux maîtresses). Ce récit plein d’humour et de cocasserie met en vedette une chatte comme objet d’adoration. Le rire éclate comme une force libératrice et salutaire au moment où les bruits de botte font trembler le Japon et l’Asie, et annoncent une période historique très sombre. Voulant publier Quatre sœurs en 1943, Il doit affronter la censure, l’ouvrage n’étant pas assez « nationaliste ». Le livre ne paraîtra finalement qu’en 1948.
Après la guerre, Tanizaki renoue avec ses tendances profondes et ses fantasmes puissants. Il affirme qu’au royaume des passions, l’homme est toujours en lutte.
Son état de santé s’aggrave après 1960. Le désir de se délivrer de la souffrance physique et de l’obsession de la mort constitue le thème essentiel de l’œuvre tragi-comique Journal d’un vieux fou (Fūtenrōjin nikki, 1961), dans lequel résonnent encore son humour et son goût de la provocation.
Il meurt en 1965 à Tōkyō.
- Un amour insensé (Chijin, 1924), roman
- Deux amours cruelles (1932-1933), nouvelles
- Bruine de neige [Quatre sœurs] (Sasameyuki, 1943), roman
- La Clef [La confession impudique] (Kagi, 1956), roman
- Journal d’un vieux fou (Foten rōjin nikki, 1961), roman

Kawabata Yasunari(1899 - 1972)
Considéré comme un écrivain majeur du XXe siècle et obsédé par la quête du beau, la solitude et la mort, il a écrit en particulier des récits très courts, d’un dépouillement stylistique extrême. Il a obtenu le prix Nobel de Littérature en 1968.
Orphelin à trois ans, Kawabata Yasunari est élevé par ses grands-parents paternels dans la région d’Ōsaka. Après une brillante scolarité à l’école primaire de Toyokawa, il entre en 1912 au collège d’Ibaraki (préfecture d’Osaka). Il décide cette année-là de devenir écrivain et consacre désormais son temps libre à la lecture et à ses premières tentatives de création littéraire.
Sa grand-mère meurt en 1909 et son grand-père en 1914. Durement confronté à la disparition précoce de sa cellule familiale, cette expérience douloureuse se retrouvera ultérieurement dans ses écrits et semble être une des clés de son rapport obsessionnel à la solitude et à la mort .
Yasunari entre comme pensionnaire au lycée d’Ibaraki en janvier 1915. Et en septembre 1917, Yasunari monte à la capitale et réussit à entrer au Premier Lycée de Tōkyō (en section de littérature anglaise), passage obligé pour intégrer l’Université Impériale. Ses premières expériences amoureuses seront la source de plusieurs de ses romans. En mars 1924, il sort diplômé de l’Université impériale de Tōkyō et commence à être rémunéré pour ses activités d’écrivain.
En 1925, Kawabata rencontre sa future femme, Matsubayashi Hideko.
Passionné de photographie et de cinéma, il écrit le scénario d’un film muet. Sept autres films adaptés de ses romans seront tournés par divers réalisateurs et scénaristes jusqu’en 1980.
Au début des années 1930, l’image idéalisée d’Hatsuyo (une ancienne amoureuse) qui servait de support aux personnages féminins des romans disparaît pour laisser place à ses propres fantasmes. C’est alors qu’il atteint sa maturité d’homme de lettres et donne une interprétation définitive à sa conception de l’existence.
Avec la deuxième guerre sino-japonaise, puis l’entrée du Japon dans la Seconde guerre mondiale, Kawabata poursuit une activité journalistique qui le conduit par deux fois en Mandchourie, la première à l’invitation du quotidien Manshū nichinichi shinbun, la deuxième à la demande de l’armée japonaise du Kantō. Il voyage, visite Pékin et revient au Japon fin novembre, huit jours avant le déclenchement de la guerre du Pacifique. Il s’implique dans la politique militariste du pays. Bien que profondément affecté par la défaite du Japon, Kawabata se remet à publier des nouvelles et un roman sur le thème des kamikaze. Il déménage dans le quartier de Hase à Kamakura dans ce qui sera sa dernière demeure.
En 1947, il publie dans la revue Ningen (qu’il a fondée avec Takami Jun) l’un des premiers écrits de Mishima Yukio. Ce sera le début d’une longue amitié littéraire. Les années qui suivent seront particulièrement riches pour son oeuvre, malgré deux importantes hospitalisations en 1958 et 1960.
1968 sera l’année du sacre et de la notoriété mondiale : le prix Nobel de littérature lui est décerné le 19 octobre. Yasunari est le premier écrivain japonais à obtenir cette récompense.
En 1972, Yasunari est hospitalisé pour une appendicite, sa santé est précaire. À 72 ans et 10 mois, bien que réticent à l’idée du suicide, il choisit le gaz pour mettre fin à ses jours le 16 avril, discrètement, sans explication ni testament, dans la solitude d’un petit appartement qui lui servait de bureau secondaire au bord de la mer à Zushi (à proximité de Kamakura).
Kawabata Yasunari est unanimement considéré comme un écrivain majeur du XXe siècle. Ses ouvrages sont le fruit d’une recherche esthétique inédite, visant l’expression la plus essentielle des sensations. Sa langue réfute le discours littéraire et intellectuel traditionnel et se veut éloignée de toute tentation argumentaire ou explicative.
La grande diversité des thèmes abordés reflète une œuvre aussi variée que cohérente qui concilie réel, quotidien, irrationnel et universalité. Certains écrits d’une forme particulièrement brève et d’un dépouillement stylistique extrême donnent à ces récits une puissance évocatrice et suggestive stupéfiante.
- La Danseuse d’Izu (Izu no odokiro, 1926-1953), recueil de cinq nouvelles
- Pays de neige (Yukiguni, 1935-1948), roman
- Le Maître ou le tournoi de go (Meijin, 1942-1954), roman
- Le Lac (Mizuumi, 1954-1955), roman
- Les Belles endormies (Nemureru bijo, 1960-1961), roman
- Tristesse et beauté (Utsukushisa to kanashimi to, 1961-1965), roman

Inoue Yasushi(1907 - 1991)
Né le 6 mai 1907 à Asahikawa, sur l’île d’Hokkaidō, Inoue Yasushi, fils d’un chirurgien militaire souvent muté, est pendant un temps élevé par la maîtresse de son arrière-grand-père, une ancienne geisha qu’il appelle grand-mère (alors qu’elle est étrangère à la famille Inoue).
Il écrit des poèmes dès 1929. Après des études en philosophie à Kyōto et une thèse sur Paul Valéry, il se lance dans la littérature, en publiant des poèmes et nouvelles dans des magazines, puis dans le journalisme, carrière entrecoupée par le service militaire (1937-1938).
Il se fait connaître grâce à une nouvelle récompensée par le prestigieux Prix Akutagawa en 1949 : Combats de taureaux (Tōgyū). Il se met ensuite à publier un grand nombre de romans et de nouvelles dont les thèmes sont souvent historiques et minutieusement documentés comme La Tuile de Tenpyō (1957) ou Le Maître de thé (1981).
Élu en 1964 à l’Académie des Arts, il préside en outre l’Association littéraire japonaise de 1969 à 1972. Il reçoit l’Ordre National du Mérite en 1976. Il sera également élu vice-président du PEN Club International en 1984.
Il meurt le 29 janvier 1991 à Tōkyō.
Plusieurs de ses oeuvres ont été adaptées au cinéma.
- Le Fusil de chasse (Ryōjū, 1949), roman court épistolaire
- Combat de taureaux (Tōgyū, 1950), nouvelles, prix Akutagawa
- La Tuile de Tenpyō (Tenpyō no iraka,1957), roman
- Le Maître de thé (Honkaku bō ibun, 1981), roman

Abe Kōbō(1923 - 1993)
Abe Kōbō (Abe Kimifusa) est né en 1924.
Il passe son enfance à Mukden en Mandchourie, où son père travaille en tant que médecin. Il possède alors une collection d’insectes, ce dont il se souviendra dans son roman La Femme des sables. Il développe un grand intérêt pour les mathématiques, la philosophie (Heidegger, Jaspers, Nietzsche) et la littérature (Dostoïevski et Edgar Allan Poe). Il doit revenir à Tokyo en 1941 pour effectuer son service militaire, expérience qui le rend profondément antimilitariste. Il fait ensuite des études de médecine, de 1943 à 1948, tout en écrivant des poèmes et des nouvelles. Il échoue à plusieurs reprises à ses examens, puis abandonne ses études pour se consacrer totalement à la littérature, sa femme Machi, une dessinatrice connue, illustrant ses œuvres.
Son court roman, Kabe (Les Murs), obtient en 1951 le prix Akutagawa, le plus grand prix littéraire japonais. Écrivain, mais aussi militant communiste, il participe au groupe Littérature populaire, organise un cercle littéraire dans un quartier d’usines et publie dans d’innombrables revues. En 1962, paraît La Femme des sables, roman qui obtient au Japon le prix du Yomiuri, en France le prix du Meilleur livre étranger et qui fait l’objet d’un film mis en scène par Hiroshi Teshigahara. Inscrit au Parti communiste japonais depuis 1945, Abe Kōbō en est exclu après la publication de cet ouvrage, dont le thème, la perte d’identité, n’est guère en accord avec l’idéologie communiste.
Dès le milieu des années 1950, il commence à écrire pour le théâtre. À ce jour, sa seule pièce traduite en France, Les Amis (1967), est le récit absurde d’un homme ordinaire qui voit son appartement envahi par une famille qui impose bientôt sa loi, grâce à des votes « démocratiques » où, grâce au nombre de ses membres la dite famille s’arroge toujours la majorité. Quand l’homme tente de se rebeller, il est mis en cage avant que la famille décide de son sort.
Dans les années 1960, Abe Kōbō signe, en collaboration avec le réalisateur Hiroshi Teshigahara, les scénarios de quatre films qui obtiennent une audience internationale.
Abe Kōbō meurt d’une faiblesse cardiaque à Tōkyō en 1993.
- Mort anonyme (1949-1966), nouvelles
- Les Murs (1951), nouvelles
- La Femme des sables (1962), roman

Mishima Yukio(1925 - 1970)
Mishima Yukio (nom de plume de Hiraoka Kimitake) est né le 14 janvier 1925.
Séparé du reste de sa famille par sa grand-mère qui le retire à sa mère pour le prendre en charge, Mishima rejoint sa famille à douze ans et développe une relation très forte avec sa mère. Celle-ci le réconforte et l’encourage à lire. Son père, employé de ministère et bureaucrate rangé, est un homme brutal, marqué par la discipline militaire, qui l’éduque en le forçant par exemple à se tenir très près d’un train fonçant à toute vitesse. Il fait également des rafles dans sa chambre pour trouver des preuves de son intérêt efféminé pour la littérature et déchire ses manuscrits.
Mishima est convoqué par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale mais prétend souffrir de tuberculose, ce qui lui permet d’échapper à la conscription. Bien qu’il fût soulagé d’avoir échappé à la guerre, il se sentira coupable d’avoir survécu et raté la chance d’une mort héroïque.
Mishima continue, malgré l’interdiction de son père, d’écrire en secret en étant soutenu par sa mère Shizue qui était toujours la première à lire ses écrits. Après l’école, son père, qui avait sympathisé avec les nazis, le contraint d’étudier le droit allemand. Tout en ayant continué d’écrire, il sort diplômé de la prestigieuse Université de Tōkyō en 1947 et entre au Ministère des finances où il est promis à une brillante carrière.
Son père accepte alors qu’il démissionne pour se consacrer un an à sa passion de l’écriture puis se résigne définitivement à voir son fils devenir écrivain. Mishima rencontre Yasunari Kawabata qui l’encourage à publier ses manuscrits.
En 1948, il publie son premier roman, Confession d’un masque, qui le rend célèbre : il n’a que 24 ans.
Jusqu’à 1970, date de sa mort, il publiera de nombreux romans qui lui permirent d’acquérir une renommée internationale.
Bien que son homosexualité ne soit qu’un secret de polichinelle, Mishima se marie en 1958. Il aura deux enfants.
Dans les années 1960, il exprime des idées fortement nationalistes. En 1967, il s’engage dans les Forces d’autodéfense du Japon puis forme la milice privée Tatenokai(« société du bouclier ») destinée à assurer la protection de l’empereur.
Le 25 novembre 1970, après une tentative de coup d’état, Mishima se donne la mort par seppuku.
- Confession d’un masque (1949), roman
- Une soif d’amour (1950), roman
- Le Pavillon d’or (1956), roman
- L’Arbre des tropiques (1960), tragédie
- Neige de printemps (1965), roman

Ōe Kenzaburō(1935 - )
Né en 1835 dans un village entouré par la forêt de l’île de Shikoku, il s’intéresse, dès l’école primaire. Son ouverture se renforce par la connaissance du travail de Kazuo Watanabe. À 18 ans, admis à l’université de Tokyo, il quitte pour la première fois son île pour étudier la littérature française et soutient une thèse sur Jean-Paul Sartre. Ce qui n’ira pas sans un certain mal du pays.
Fortement influencé par la littérature contemporaine occidentale, il s’essaie à l’écriture dès 1957 et publie son premier récit, Un drôle de travail, qui fait de lui le porte-parole de la jeune génération japonaise dont il incarne le désarroi. Il remporte, l’année suivante, le Prix Akutagawa pour son récit Gibier d’élevage, nouvelle qui sera publiée dans le recueil Dites-nous comment survivre à notre folie.
En 1960, il épouse Yukari, fille du réalisateur Mansaku Itami et sœur du réalisateur Juzo Itami. L’année suivante, paraît Ainsi mourut l’adolescent politisé, inspiré de l’assassinat de Inejirō Asanuma par Otoya Yamaguchi. En 1963, la naissance de son fils handicapé, Hikari, bouleverse sa vie. Dans le prolongement immédiat de cet événement, il écrit deux ouvrages : Une affaire personnelle, premier d’une série de récits dont le personnage central est le père d’un enfant handicapé mental puis Notes de Hiroshima, recueil d’essais sur les survivants d’Hiroshima. Ces expériences modifient définitivement sa vocation d’écrivain.
Dans les années 1980, Ōe Kenzaburō s’intéresse à la littérature latino-américaine et séjourne au Mexique où il enseigne à l’université.
Après avoir reçu le Prix Nobel de littérature en 1994, Ōe annonce qu’il n’écrira plus de romans, arguant que son fils, compositeur, a désormais sa propre voix et qu’il n’a donc plus besoin de lui apporter une possibilité d’expression par son œuvre de fiction.
Défenseur du pacifisme et de la démocratie, il milite avec d’autres intellectuels pour que le Japon ne remette pas en cause l’article 9 de sa constitution. Il a ainsi fondé en 2004 avec Shūichi Katō et d’autres, une association de défense de la Constitution pacifique. Il reprend la plume à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima, en 2011.
En 2012, il présente au Premier Ministre japonais une pétition de plus de 7 millions de signataires pour l’abandon de l’énergie nucléaire.
- Une affaire personnelle (Kojinteki na taiken, 1964), roman
- Le Jeu du siècle (Man’en gannen no futtobôru, 1967), roman

Murakami Haruki(1949 - )
Murakami Haruki est né à Kyōto en 1949, mais grandit à Ashiya (Hyōgo). Son père est le fils d’un prêtre bouddhiste et sa mère la fille d’un marchand d’Ōsaka. Les deux enseignaient la littérature japonaise. Mais Haruki, à cette époque, ne s’intéressait pas vraiment à la littérature de son pays et se plongeait plus volontiers dans des histoires de détectives américains ou de science-fiction. Point de vue artistique, les États-Unis représentent pour lui la seule culture valant la peine. En 1968, il déménage à Tōkyō pour y étudier le théâtre à l’Université Waseda ; il y passera plus de temps à lire des scénarios qu’à être un élève assidu.
En 1974, Murakami ouvre avec son épouse, Takahashi Yōko avec qui il s’est marié trois ans plus tôt, un club de jazz : le « Peter Cat » dans le quartier de Kokubunji à Tōkyō qu’ils tiendront jusqu’en 1981, date à laquelle il décide de devenir écrivain professionnel.
Entre 1986 et 1989, Murakami vit en Grèce et à Rome pour ensuite se rendre aux États-Unis où il enseigne à l’Université de Princeton et à l’Université Tufts de Medford. En 1995, il ressent une sorte d’obligation de retourner dans son pays natal qui commence à souffrir d’une grave crise économique et sociale. C’est également à cette époque qu’eut lieu le terrible tremblement de terre de Kōbe qui le marqua énormément et qui l’inspira pour son recueil de nouvelles Après le tremblement de terre, ainsi que l’attaque terroriste contre le métro de Tōkyō par la secte Aum Shinrikyō. Il reprendra d’ailleurs ce thème dans son roman 1Q84.
Murakami Haruki a créé un style original reconnaissable immédiatement. Ce style bien à lui se compose d’humour, de légèreté, de simplicité, de clarté, mais aussi de surréalisme. Il ose faire voyager ses lecteurs du réalisme à l’imaginaire pur sans crier gare. Le lecteur est tellement prisonnier de l’univers de Murakami que ça ne l’étonne absolument pas d’apercevoir des chats parler le plus naturellement possible, et tout ça, sans être choqué ou rebuté. Loin de lui la période pénible de l’après-guerre et des romans traditionnels autobiographiques. Pour preuve, le musée qu’il invente dans Kafka sur le rivage est presque devenu réel. Bon nombre de Japonais se sont rendus à l’arrêt de la gare qu’il décrit dans son roman pour demander aux employés le chemin le plus court pour arriver au musée. Quelle ne fut pas leur déception lorsque les pauvres employés éreintés devaient leur annoncer que ce musée n’a jamais existé.
Un des fils conducteurs de son œuvre est sans conteste la musique. Murakami est un passionné de musique classique et de jazz, et il ne cesse au long de ses romans de citer toutes les œuvres qu’il admire depuis si longtemps, comme s’il ne pouvait s’empêcher de faire partager ses coups de cœur à ses lecteurs.
Murakami est également le traducteur des œuvres de Francis Scott Fitzgerald, de Truman Capote, de Raymond Carver, de Paul Theroux, de John Irving, de Tim O’Brien, et de bien d’autres encore.
L’écrivain le plus populaire du Japon s’est toujours éloigné de la littérature japonaise proprement dite, ce qui lui a valu énormément de critiques à ses débuts. On dit de ses romans qu’ils semblent être écrits dans une langue étrangère et avoir ensuite été traduits en japonais. Mais tout cela ne l’a jamais empêché d’être très apprécié dans son pays et à l’étranger.
- Chroniques de l’oiseau à ressort (Nejimaki-dori kuronikuru, 1994-1995), roman
- Kafka sur le rivage (Umibe no Kafuka, 2002), roman
- 1Q84 (Ichi-kyū-hachi-yon, 2009-2010), roman
- Le Meurtre du Commandeur (Kishidancho Goroshi, 2017), roman
